Quitter la littérature
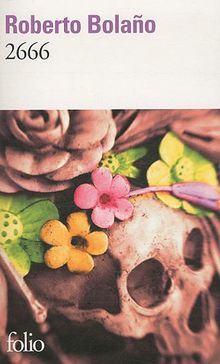
[…] J'ai été écrivain, j'ai été écrivain, mais mon indolent cerveau vorace dévorait mes entrailles. Vautour de mon propre Prométhée, ou Prométhée de mon propre vautour, un jour je me suis aperçu que je pouvais réussir à publier d'excellents articles dans les revues et les journaux, et même des livres qui ne gâchaient pas le papier sur lequel ils étaient imprimés. Mais j'ai aussi su que jamais je ne parviendrais à approcher ou à pénétrer une œuvre maîtresse. Vous me direz que la littérature ne consiste pas uniquement en œuvres maîtresses, mais qu'elle abonde en œuvres qu'on appelle mineures. Moi aussi je croyais cela. La littérature est une grande forêt, et les œuvres maîtresses sont les lacs, les arbres immenses ou très étranges, les éloquentes fleurs précieuses ou les grottes cachées, mais une forêt est aussi constituée d'arbres normaux, de fourrés, de flaques, de plantes parasites, de champignons et de petites fleurs sylvestres. Je me trompais. Les œuvres mineures n’existent pas en réalité. Je veux dire : l'auteur d'une œuvre mineure ne s'appelle pas Machin ou Truc. Machin et Truc existent, il n'y a pas de doute sur ça, et souffrent et travaillent et publient dans des journaux et des revues et de temps en temps ils publient même un livre qui ne gâche pas le papier sur lequel il est imprimé, mais ces livres ou ces articles, si vous faites attention, ne sont pas écrits par eux.
Toute œuvre mineure a un auteur secret, et tout auteur secret est, par définition, un écrivain d’œuvres maîtresses. Qui a écrit telle œuvre mineure ? Apparemment, un écrivain mineur. La femme de ce pauvre écrivain peut en témoigner, elle l'a vu assis à sa table, penché sur les pages blanches, se tordant et faisant glisser sa plume sur le papier. Elle a l'air d'être un témoin irréfutable. Mais ce qu'elle a vu, ce n'est que la partie extérieure. La coquille de la littérature. Une apparence, dit le vieillard ex-écrivain à Archimboldi et Archimboldi se souvient d'Ansky. Celui qui en vérité est en train d'écrire cette œuvre mineure est un écrivain secret qui n'accepte que la dictée d’une œuvre maîtresse.
Notre bon artisan écrit. Il est absorbé par ce qu’il est en train de mettre en forme bien ou mal sur le papier. Sa femme, sans qu'il le sache, l'observe. En effet, c'est lui qui écrit. Mais si sa femme avait une vision aux rayons X, elle s'apercevrait qu'elle n'assiste pas réellement à un exercice de création littéraire, mais bien plutôt à une séance d'hypnose. À l'intérieur de l'homme qui est assis en train d'écrire il n'y a rien. Rien qui soit lui, je veux dire. Comme ce pauvre homme ferait mieux de se consacrer à la lecture. La lecture est plaisir et joie d'être vivant ou tristesse d'être vivant et surtout elle est connaissance et questions. L'écriture, en revanche, est d'ordinaire vide. Dans les entrailles de l'homme qui écrit il n’y a rien. Rien, je veux dire, que sa femme, à un moment, puisse reconnaître. Il écrit sous la dictée. Son roman, ou son recueil de poèmes, convenables, très convenables, sortent, non par un exercice de style ou de volonté, comme le pauvre malheureux le croit, mais grâce à un exercice d’occultation. Il est nécessaire qu’il y ait beaucoup de livres, beaucoup de beaux sapins, pour qu’ils veillent du coin de l'œil le livre qui importe réellement, la foutue grotte de notre malheur, la fleur magique de l'hiver.
Pardonnez ces métaphores. Parfois, je m’emporte et je deviens romantique. Mais écoutez. Toute œuvre qui n’est pas une œuvre maîtresse est, comment vous dire, une pièce d'un vaste camouflage. Vous avez été soldat, j'imagine, et vous savez déjà de quoi je parle. Tout livre qui n'est pas une œuvre maîtresse est chair à canon, infanterie vaillante, pièce sacrifiée puisqu'elle reproduit, de multiples manières, le schéma de l'œuvre maîtresse. Lorsque j'ai compris cette vérité, j'ai arrêté d'écrire. Mon esprit, cependant, n'a pas cessé de fonctionner. Au contraire, il fonctionne mieux sans écrire. Je me suis demandé : pourquoi une œuvre maîtresse a-t-elle besoin d'être occulte ? Quelles forces étranges l'entraînent vers le secret et le mystère ?
Je savais déjà qu'écrire était inutile. Ou que cela ne valait la peine que si l'on était disposé à écrire une œuvre maîtresse. La plus grande partie des écrivains se trompe, ou bien joue. Peut-être que se tromper ou jouer, c'est la même chose, les deux côtés de la même pièce de monnaie. En réalité, nous ne cessons d’être des enfants, des enfants monstrueux pleins de boutons de fièvre, de varices, de tumeurs et de taches cutanées, mais des enfants en fin de compte, c'est-à-dire que nous ne cessons jamais de nous accrocher à la vie, puisque nous sommes vie. On pourrait aussi dire : nous sommes théâtre, nous sommes musique. De la même manière, ils sont peu nombreux les écrivains qui renoncent. Nous jouons à nous croire immortels. Nous nous trompons en jugeant nos propres œuvres et en jugeant, toujours de manière imprécise les œuvres des autres. Rendez-vous au Nobel, disent les écrivains, comme qui dirait : Rendez-vous en enfer.
Une fois j'ai vu un film américain de gangsters. Il y avait une scène où un inspecteur tuait un malfaiteur et il lui disait, avant d'appuyer sur la gâchette fatale : Rendez-vous en enfer. Il est en train de jouer. Le flic est en train de jouer et de se tromper. Le malfaiteur, qui le regarde et l'insulte juste avant de mourir, lui aussi est en train de jouer et de se tromper, même si son terrain de jeux et son terrain d'erreurs se sont réduits presque au zéro absolu, puisque, au plan suivant, il sera mort. Le réalisateur lui aussi joue. Le scénariste, pareil. Rendez-vous au Nobel. Nous avons fait de l'histoire. Le peuple allemand nous en est reconnaissant. Une bataille héroïque qui restera dans le souvenir des générations à venir. Un amour immortel. Un nom gravé dans le marbre. L'heure des muses. Même une phrase aussi apparemment innocente que celle-ci : des échos de la prose grecque ne contiennent que du jeu et de l'erreur.
Le jeu et l'erreur sont le bandage et le ressort des écrivains mineurs. Et aussi : ils constituent la promesse de leur bonheur futur. Une forêt qui pousse à une vitesse vertigineuse, une forêt à qui personne ne met de frein, pas même les Académies, au contraire, les Académies se chargent de ce qu'elle pousse sans problème, et les entrepreneurs et les universités (pépinières de clochards), les bureaux de l'Etat, les mécènes, les associations culturelles, les déclamatrices de poésie, tous contribuent à ce que la forêt pousse et cache ce qu'elle doit cacher, tous contribuent à ce que la forêt reproduise ce qu’elle doit reproduire, puisqu'il est inévitable qu’elle fasse, mais sans jamais révéler ce qu'elle reproduit, ce qu'elle reflète doucement.
Un plagiat, direz-vous ? Oui, un plagiat dans le sens où toute œuvre mineure, toute œuvre issue de la plume d'un écrivain mineur, ne peut être qu’un plagiat d'une œuvre maîtresse quelconque. La petite différence est qu'ici nous parlons d'un plagiat consenti. Un plagiat qui est un camouflage qui est une pièce dans une scène bigarrée qui est une charade qui probablement nous conduira au vide.
En un mot : ce qu'il y a de mieux, c'est l'expérience. Je ne vous dirai pas que l'expérience ne s'acquiert pas par la relation constante avec une bibliothèque, mais l’expérience l'emporte sur la bibliothèque. L'expérience est la mère de la science, a-t-on l'habitude de dire. Lorsque j'étais jeune, et que je pensais encore que je ferais carrière dans le monde des lettres, j'ai connu un grand écrivain. Un grand écrivain qui avait probablement écrit une œuvre maîtresse, et même, pour moi, toute sa production était une œuvre maîtresse.
Je ne vais pas vous dire son nom. Ça n'est pas intéressant pour vous, et pour l'histoire, il n'est pas indispensable de le connaître. Contentez-vous de savoir qu’il était allemand et qu'un jour il est venu à Cologne donner quelques conférences. Évidemment, je n'ai pas raté un seul des trois exposés qu'il présenta à l’université de notre ville. Lors de la dernière conférence, j'avais réussi à trouver un siège au premier rang, et je me suis appliqué, davantage qu'à l'écouter (en réalité, il répétait des choses qu'il avait déjà dites au cours des première et deuxième conférences), à l’observer minutieusement, à observer ses mains par exemple, des mains énergiques et osseuses, son cou de vieil homme, pareil au cou d'un dindon ou d'un coq déplumé, ses pommettes légèrement slaves, les lèvres exsangues, des lèvres qu'on pouvait entailler avec un couteau et dont on pouvait être certain qu'il ne coulerait pas une goutte de sang, ses tempes grises comme une mer démontée, et surtout ses yeux, des yeux profonds et qui, à certains légers mouvements de sa tête, prenaient parfois l'apparence de deux tunnels sans fond, deux tunnels abandonnés, sur le point de s’effondrer.
Évidemment, sa conférence une fois terminée, il fut accaparé par les notables de la ville et je n'ai même pas pu lui serrer la main et lui dire combien je l’admirais. Le temps a passé. Cet écrivain est mort et moi, comme c'est logique, j'ai continué à le lire et à le relire. Est arrivé le jour où j'ai pris la décision de quitter la littérature. Je l'ai quittée. Ce n'est pas un traumatisme que l'on ressent en franchissant ce pas, mais plutôt une libération. Entre nous, je vous avouerai que c'est comme cesser d’être vierge. Un soulagement, quitter la littérature, c'est-à-dire cesser d'écrire et se limiter à lire !
Extrait du roman de Roberto Bolaño « 2666 », Folio Gallimard,
pages 1189 à 1194.
Traduit de l’espagnol
(Chili) par Robert Amutio.
Ce texte est prononcé par un vieillard, en réponse à Hans Reiter (Benno von Archimboldi) qui souhaite lui emprunter une machine à écrire.
Libellés : Roberto Bolaño


































0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home